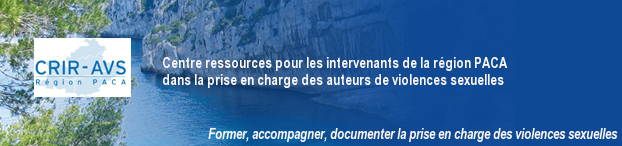Historique
Historique et éléments actuels :
Longtemps la question des agressions sexuelles s’est réduite :
- dans le champ psychiatrique, au diagnostic de perversion sexuelle et ses corollaires, à l’absence de demande et l’inaccessibilité au soin psychique,
- dans le champ pénitentiaire, à une catégorie pénale certes stigmatisée mais ne posant pas de difficultés particulières de gestion en milieu pénitentiaire.
Depuis la fin des années 80, le nombre des infractions sexuelles et des personnes condamnées à l’instar de la représentation de cette population vis-à-vis de la population incarcérée, a connu des variations importantes : forte augmentation depuis les années 80 puis diminution et relative stabilisation depuis 2005 le tout sous des contingences particulières (variations conditionnées entre autres par le nouveau Code Pénal de 1994, par les changements dans les modalités de recueil des données, etc.).
Ainsi, on peut citer à titre d’exemple des variations recensées (opale/is 2011) :
1) Pour les faits constatés de violence :
- en 1980 : 8203
- en 1990 :13344
- en 2000 : 22721
- en 2004 : 26238
- en 2010 : 22963
2) Pour les personnes condamnées :
- En 1970 : 1326 soit 7,4% de la population carcérale
- En 1983 : 1473 soit 8,8% de la population carcérale
- En 1990 : 2144 soit 9% de la population carcérale
- En 1997 : 4835 soit 10,1% de la population carcérale
- En 2004 : 7446 soit 21,4% de la population carcérale
- En 2011 : 7631 soit 14,9% de la population carcérale
La prévention des récidives délinquantes ou criminelles reste une préoccupation sociale importante.
Les travaux de Claude Balier psychanalyste des prisons et le rapport de recherche sur les agresseurs sexuels de Claude Balier, André Ciavaldini et Martine Girard-Khayat qui ont montré que la majorité des auteurs d’infractions à caractère sexuel sont accessibles à des soins et insistent sur l’intérêt dans certains cas, d’une approche complémentaire judiciaire et psychiatrique (les soins sont assortis d’une mesure de justice qui fonctionne comme un encadrement surmoïque externe) et sur la nécessaire articulation des deux dispositifs. Ces avancées ont eu pour conséquences 2 éléments essentiels :
- Le premier sur le plan juridique avec la loi du 17 juin 1998 qui prévoyait, en cas d’infraction sexuelle, la possibilité de prononcer une peine complémentaire (à moins qu’elle ne constitue la peine principale) de suivi socio-judiciaire (SSJ) assorti, si une expertise médicale l’indique et si le sujet y consent, d’une injonction de soin.
Ce suivi socio-judiciaire prend effet à l’issue de la peine d’emprisonnement, sachant que durant l’incarcération, le condamné aura été incité aux soins.
Les auteurs d’infraction sexuelle faisant l’objet d’une injonction de soin relèvent à la fois d’une prise en charge médico-psychologique et d’une prise en charge socio-judiciaire. Est essentiel à cet égard le rôle d’interface Santé-Justice du médecin-coordonnateur, désigné par le juge de l’application des peines pour s’assurer du bon déroulement de la mesure.
Depuis le champ de cette injonction a été considérablement étendu au-delà des infractions à caractère sexuel.
- Le deuxième, résumé dans le champ sanitaire par la circulaire DHOS-DGS du 13 avril 2006, qui a participé à la création du CRIR-AVS PACA et des autres CRIAVS, améliorée depuis par la circulaire DHOS du 8 août 2008 qui a affirmé la compétence régionale des centres ressources.
Les missions évoquées pour les CRIAVS dans la circulaire de 2006 sont toujours d’actualité :
- faciliter l’accès aux soins par une offre adaptée,
- spécifier la prise en charge des mineurs,
- améliorer les connaissances et augmenter le nombre des médecins coordonnateurs,
- améliorer la qualité de l’expertise pénale,
- améliorer les connaissances d’un plus grand nombre de professionnels de la psychiatrie,
- élaborer des référentiels de pratiques visant à clarifier l’articulation des différentes prises en charges (sanitaire, judiciaire, sociale, éducative).
Les recherches sur ces bases ont connu depuis cette époque un foisonnement important et associent dans les différents champs concernés les contributions des différents acteurs.
À cet égard, citons l’ARTAAS, association pour la recherche et le traitement des auteurs d’agressions sexuelles, qui a initialement joué un rôle essentiel et poursuit actuellement cette mission et également la FF. CRIAVS (fédération française des centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles) de création récente et qui a posé les principes d’une coopération entre les différents CRIAVS.