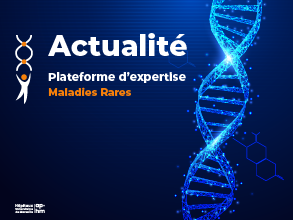Hémophilie B : utilisation et efficacité du facteur IX recombinant Fc
Il existe près de 7.000 maladies rares, soit près de 3 millions de patients en France et 300 millions dans le monde. La maladie rare est définie par une fréquence de moins d’un cas pour 2000 personnes. À l’AP-HM, pour prendre en charge ces patients, 87 centres sont répartis dans les services et accueillent plus de 50 000 patients par an. Tous les mardis, la plateforme d’expertise maladies rares de l’AP-HM partage avec vous les actions réalisées à l’hôpital : publications scientifiques, participations à une étude, présentations de centres ou d’événements, paroles de patients ou de soignants, etc. C’est une façon de mettre en valeur et faire connaître le travail remarquable des professionnels de santé pour accueillir et aider au mieux les patients et les familles touchés par les maladies rares. Suivez-nous sur notre site internet ou notre page LinkedIn
L’étude B-SURE, conduite sur 24 mois dans 21 centres de ressources et de Compétences de la filière MHéMO des maladies hémorragiques rares, dont celui de l’AP-HM, confirme en vie réelle l’efficacité et la sécurité du rFIXFc, une protéine recombinante à demi-vie prolongée du facteur IX de coagulation. Elle met en évidence une réduction des saignements, consolidant son intérêt chez les patients atteints d’hémophilie B sévère.
L’hémophilie B est une maladie génétique rare caractérisée par un déficit en facteur IX (FIX), une protéine essentielle à la coagulation du sang. Transmise selon l’hérédité récessive liée au chromosome X, cette pathologie touche presque exclusivement les garçons avec une prévalence variant entre 1 sur 100 000 et 1 sur 30 000 naissances.
Bien que les traitements curatifs (thérapie génique) restent encore peu accessibles, l’hémophilie B peut être contrôlée, notamment par un traitement substitutif basé sur les injections de FIX. Les patients doivent néanmoins éviter les activités à risque de chocs ou de blessures, afin de préserver leurs articulations et prévenir les saignements.
Le traitement de l’hémophilie B consiste à injecter, par voie intraveineuse, des médicaments à base FIX, administrées soit de manière prophylactique pour prévenir les saignements, soit à la demande en cas d’épisode hémorragique. Toutefois, les concentrés classiques de FIX présentent une demi-vie relativement courte (environ 20 à 24 heures), ce qui nécessite des injections fréquentes.

Le Pr Chambost est responsable du Centre de Ressources et de Compétences des Maladies Hémorragiques Rares à l'hôpital de la Timone à Marseille.
L’étude B-Sure pour évaluer le traitement rFIXFc
Pour améliorer la prise en charge, des versions à demi-vie prolongée de FIX recombinants ont été développées. C’est le cas de l’eftrénonacog alfa (rFIXFc), une protéine de fusion recombinante à longue durée d’action, combinant le FIX humain à un fragment Fc d’immunoglobuline G1. Ce médicament a démontré son efficacité et sa sécurité dans plusieurs essais cliniques. Toutefois, des données complémentaires issues de la vie réelle sont essentielles pour confirmer ces résultats dans la pratique quotidienne chez les personnes atteintes d’hémophilie B.
L'étude B-SURE est une étude prospective, non interventionnelle, d'une durée de 24 mois, menée dans plusieurs centres en France, dont le Centre de Ressources et de Compétences des Maladies Hémorragiques Rares de l’AP-HM, coordonné par le Professeur Hervé Chambost. Récemment, les chercheurs ont publié les résultats finaux de cette recherche, qui évaluait l'utilisation en conditions réelles et l'efficacité du traitement par rFIXFc.
84 patients analysés dans l’étude B-Sure
L’étude B-SURE a porté sur 91 patients masculins atteints d’hémophilie, suivis dans 21 centres en France. Ces patients, d’âges et de niveaux de sévérité variés, étaient traités par facteur IX (FIX). Parmi eux, 84 ont reçu le rFIXFc, soit en prophylaxie, soit en traitement à la demande.
Les chercheurs ont analysé plusieurs critères, notamment le taux annualisé de saignements (ABR), la fréquence des injections et la consommation de facteur IX. En parallèle, des données rétrospectives sur six mois de traitement par FIX avant le passage au rFIXFc ont été recueillies. Seuls les patients ayant bénéficié d’au moins trois mois de traitement avant et après le changement ont été inclus dans cette comparaison.
Sécurité et efficacité du rFIXFc en vie réelle
Parmi les patients inclus, 68 avaient déjà reçu une prophylaxie par facteur IX. Sous traitement prophylactique par rFIXFc, ces patients ont présenté un taux annualisé de saignements médian faible, une fréquence d’injection réduite, ainsi qu’une consommation moyenne de facteur de 2844 UI/kg/an. L’analyse a montré une diminution moyenne de l’ABR de 40 %, une réduction de la fréquence d’injection de 38,2 injections/an, et une baisse de la consommation moyenne de facteur de 1 008 UI/kg/an.
Chez les patients précédemment traités à la demande, l’instauration de la prophylaxie par rFIXFc a permis une réduction moyenne de l’ABR de 84 %, accompagnée d’une diminution de la fréquence d’injection de 2,13 injections/an. Toutefois, la consommation moyenne de facteur IX a augmenté de 381,8 UI/kg/an.
Par ailleurs, le rFIXFc a été bien toléré, sans nouvelle préoccupation identifié au cours de l’étude.
Ces résultats confirment la sécurité et l’efficacité du rFIXFc tout en maintenant, voire en améliorant, la prévention des saignements.
Un grand merci à toute l’équipe pour ce travail et en particulier au Professeur Hervé Chambost, premier auteur et responsable du Centre de Ressources et de Compétences des Maladies Hémorragiques Rares.
Pour aller plus loin, voici le lien vers l’article