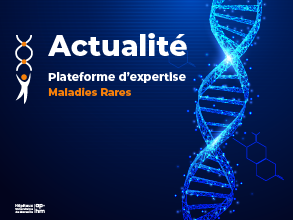Le digénisme dans la maladie de Charcot–Marie–Tooth
Il existe près de 7.000 maladies rares, soit près de 3 millions de patients en France et 300 millions dans le monde. La maladie rare est définie par une fréquence de moins d’un cas pour 2.000 personnes. À l’AP-HM, pour prendre en charge ces patients, 87 centres sont répartis dans les services et accueillent plus de 50.000 patients par an. Tous les mardis, la plateforme d’expertise maladies rares de l’AP-HM partage avec vous les actions réalisées à l’hôpital : publications scientifiques, participations à une étude, présentations de centres ou d’événements, paroles de patients ou de soignants, etc. C’est une façon de mettre en valeur et faire connaître le travail remarquable des professionnels de santé pour accueillir et aider au mieux les patients et les familles touchés par les maladies rares. Suivez-nous sur notre site internet ou notre page LinkedIn.
La maladie de Charcot–Marie–Tooth (CMT) est généralement une maladie monogénique, c’est-à-dire causée par une mutation dans un seul gène. Toutefois, certains cas peuvent être polygéniques, impliquant des mutations dans deux gènes, un phénomène appelé digénisme. Une étude récente, menée par Nathalie BONELLO-PALOT à l’Hôpital de la Timone, explore le processus et apporte de nouvelles pistes pour mieux diagnostiquer et prendre en charge les patients.
La maladie de Charcot-Marie-Tooth (CMT), une neuropathie héréditaire rare
La CMT est une maladie génétique rare qui touche les nerfs périphériques, responsables de la transmission des informations entre la moelle épinière et les muscles. Elle provoque une faiblesse musculaire et une perte de sensibilité, principalement dans les jambes et les bras. Les premiers symptômes apparaissent le plus souvent dès l’enfance avec une évolution lente mais la maladie peut parfois rester silencieuse jusqu’à l’âge adulte. Elle touche environ 1 personne sur 2500.
Le diagnostic clinique repose sur un examen neurologique et des tests électrophysiologiques. Identifier la cause génétique est également essentiel pour confirmer le diagnostic et proposer une prise en charge et un conseil génétique adapté au patient.
Les mutations responsables de la CMT touchent des gènes clés impliqués dans la formation et le maintien des nerfs périphériques. À ce jour, plus de 100 gènes ont été associés à la maladie, ce qui explique en partie la grande diversité des formes cliniques observées.
Le digénisme dans la CMT
La CMT est généralement due à une mutation dans un seul gène, mais des cas de digénisme ont été rapportés. Ce terme désigne une situation où la maladie n’est pas provoquée par une mutation dans un seul gène, mais par la combinaison de mutations présentes dans deux gènes distincts. Chacune de ces mutations peut contribuer à un aspect différent de la maladie, rendant son origine plus complexe.
Le digénisme a été décrit pour plusieurs gènes impliqués dans la CMT, la plupart codant pour des protéines intervenant dans des voies biologiques similaires ou complémentaires. Identifier ces cas est crucial pour mieux comprendre la maladie et améliorer le diagnostic ainsi que le conseil génétique.
Une étude rétrospective sur 1665 patients
Une étude coordonnée par le Dr Nathalie BONELLO-PALOT au sein du laboratoire de génétique moléculaire de l’Hôpital de la Timone, s’est penchée sur le digénisme dans la CMT. À l’AP-HM, le centre de référence des maladies neuromusculaires PACA/Réunion/Rhône Alpes coordonné par le Pr Shahram ATTARIAN a notamment participé à cette étude. Le Pr Karine NGUYEN, chef de service de génétique médicale et responsable de plusieurs centres de compétence maladies rares figure également parmi les auteurs de cette recherche.


Le Docteur BONELLO-PALOT (à gauche) est la coordinatrice de cette recherche, menée notamment avec la collaboration du centre de référence des maladies neuromusculaires PACA/Réunion/Rhône Alpes coordonné par le Professeur Shahram ATTARIAN (à droite)
Les auteurs ont analysé les données de 1665 patients atteints de CMT et ayant bénéficié d’un séquençage à haut débit (NGS) ciblant le panel de gènes connus de la CMT entre 2016 et 2024. Ces patients provenaient de centres de référence en neurologie en France. Le NGS a permis de poser un diagnostic chez 367 personnes, soit 22 % des cas, sans compter la duplication du gène PMP22, détectée séparément chez 650 patients supplémentaires, soit 39 % des cas.
Parmi les résultats positifs, 15 patients présentaient des mutations dans deux gènes différents, soit un taux de digénisme de 4 %. Chez 5 patients, les deux gènes concernés étaient MFN2 et GDAP1, ce qui représente 1,4 % de l’ensemble des résultats positifs et un tiers des cas de digénisme. Ces deux gènes, déjà associés à des cas de digénisme de CMT, sont tous les deux impliqués dans la dynamique mitochondriale : MFN2 permet la fusion mitochondriale et GDAP1 la fission mitochondriale.
Un digénisme fréquent et cliniquement important
Grâce aux nouvelles technologies de séquençage, la détection du digénisme s’est améliorée. Cette étude montre que le digénisme représente 4 % des diagnostics confirmés, avec une surreprésentation de l’association MFN2/GDAP1 (1/3 des cas de digénisme de CMT). D’autre part, quand ces deux gènes sont affectés, la maladie débute plus tôt et est responsable de formes plus sévères.
Le digénisme pourrait expliquer en partie la variabilité en termes de sévérité des symptômes entre patients. Cependant, il complique le conseil génétique, car la transmission ne suit plus les règles classiques dites mendéliennes, ce qui complique le conseil génétique et donc la prédiction du risque pour les enfants et complique les décisions médicales pendant la grossesse.
Cette recherche ouvre la voie à une meilleure identification des cas de digénisme, pour une prise en charge optimisée des patients.
Merci à l’équipe de génétique de l’hôpital de la Timone et tout particulièrement à Nathalie BONELLO-PALOT pour son travail et son engagement auprès des patients.
Pour en savoir plus, voici le lien vers l’article complet.