Nature reviews rheumatology : focus sur la maladie liée à l’IgG4
Il existe près de 7.000 maladies rares, soit près de 3 millions de patients en France et 300 millions dans le monde. La maladie rare est définie par une fréquence de moins d’un cas pour 2000 personnes. À l’AP-HM, pour prendre en charge ces patients, 87 centres sont répartis dans les services et accueillent plus de 50 000 patients par an. Tous les mardis, la plateforme d’expertise maladies rares de l’AP-HM partage avec vous les actions réalisées à l’hôpital : publications scientifiques, participations à une étude, présentations de centres ou d’événements, paroles de patients ou de soignants, etc. C’est une façon de mettre en valeur et faire connaître le travail remarquable des professionnels de santé pour accueillir et aider au mieux les patients et les familles touchés par les maladies rares. Suivez-nous sur notre site internet ou notre page LinkedIn
Identifiée il y a un peu plus de 20 ans, la maladie assciée aux IgG4 reste encore largement méconnue. Le Pr Nicolas Schleinitz, expert reconnu dans ce domaine et responsable du centre de référence coordonnateur des maladies auto-immunes, auto-inflammatoires systémiques et pathologies infiltratives et fibrosantes associées aux IgG4 (CERAINOM-IgG4), a participé à la rédaction d’une revue de référence sur le sujet. Dans cet article, publié dans Nature Reviews Rheumatology, les auteurs font le point sur les dernières avancées et les nouvelles options thérapeutiques.
Découverte de la maladie liée à l’IgG4
Tout commence en 2001, lorsqu’un taux élevé d’IgG4 est identifié chez des patients atteints de pancréatite auto-immune. Peu à peu, des travaux démontrent que plusieurs maladies jusqu’alors considérées comme distinctes sont en réalité les différentes manifestations d’une même pathologie : la maladie liée à l’IgG4 (IgG4-RD). Cette pathologie provoque une inflammation chronique et une fibrose dans divers organes. Elle se caractérise par une infiltration de cellules immunitaires de type IgG4+ et par des lésions pseudo-tumorales, souvent multisites. Elle touche majoritairement les hommes, chez qui elle est souvent plus sévère.
À Marseille, le centre CERAINOM IgG4, rattaché au service de médecine interne de l’hôpital de la Timone (AP-HM), est dirigé par le Pr Schleinitz. Il coordonne le diagnostic, le suivi et la prise en charge des patients, tout en animant un réseau national dédié à l’amélioration des connaissances et des soins liés à cette maladie rare.
Equipe du centre CERAINOM IgG4
Prédispositions et mécanismes
L’IgG4-RD résulte d’une combinaison de facteurs génétiques, environnementaux et immunitaires. Certains gènes ainsi que des expositions comme le tabac ou l’amiante augmentent le risque. Des cellules immunitaires telles que les lymphocytes B, les lymphocytes T et certains macrophages jouent un rôle clé dans l’inflammation et la fibrose. Toutefois, les mécanismes précis à l’origine de la maladie restent encore mal compris.
Un diagnostic complexe
Malgré les progrès réalisés ces 20 dernières années, aucun test spécifique ni critère diagnostique universel n’existe. L’IgG4-RD peut toucher de nombreux organes (tête, foie, pancréas, aorte, etc.) avec des présentations très variables, tant cliniquement que biologiquement.
Depuis 2019, des critères ont été établis pour améliorer le diagnostic, combinant examens cliniques, analyses sanguines, imagerie et biopsies. Le processus repose sur l’identification d’une atteinte typique (comme une masse ou une inflammation dans certains organes), l’exclusion d’autres maladies et un système de points permettant une confirmation fiable. Toutefois, certaines pathologies présentent des signes similaires, rendant le diagnostic parfois difficile.
Au microscope, la maladie se reconnaît par une inflammation caractéristique (présence de plasmocytes, fibrose, inflammation veineuse) et par la détection de cellules IgG4+ grâce à des colorations spécifiques. L’imagerie (échographie, scanner, IRM, etc.) permet de localiser et suivre l’évolution de la maladie. Un taux élevé d’IgG4 dans le sang est aussi un indice important mais non exclusif.
Traitements
L’IgG4-RD évolue lentement ; un traitement urgent n’est généralement nécessaire qu’en cas de complications. Une simple surveillance peut suffire chez les patients asymptomatiques avec une atteinte localisée.
- Les corticoïdes sont le traitement de première ligne. Leur efficacité est généralement bonne, mais leurs effets secondaires à long terme, en particulier chez les personnes âgées, limitent leur utilisation prolongée.
- Les thérapies ciblant les lymphocytes B, notamment le rituximab, sont efficaces chez la majorité des patients, notamment en cas de maladie sévère, de rechute ou d’intolérance aux corticoïdes. De nouvelles molécules comme l’inebilizumab (Anti CD19) ont montré des résultats prometteurs dans les essais cliniques.
- Les traitements agissant sur les lymphocytes T, semblent également prometteurs chez certains patients.
- Les approches ciblant certaines cytokines n’ont, pour l’instant, pas montré de bénéfices clairs. En revanche, les inhibiteurs de Janus kinases (JAK), tels que le tofacitinib, suscitent un intérêt croissant, avec des essais en cours.
Les recherches futures devront s’attacher à identifier de nouveaux biomarqueurs diagnostiques, des facteurs pronostiques spécifiques à la maladie ou aux organes atteints, et à développer des traitements plus accessibles, en intégrant les retours des patients.
Un grand merci aux auteurs pour ce travail rigoureux de mise à jour des connaissances sur l’IgG4-RD, et tout particulièrement à l’équipe du Département de Médecine Interne 7eme étage Timone pour son engagement dans la prise en charge des pathologies immunitaires.
Pour en savoir plus : lien vers l’article complet
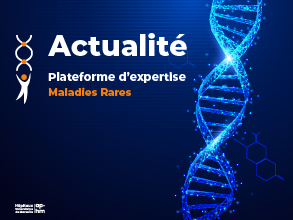






.JPG)