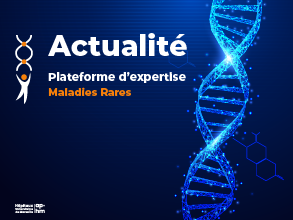Rencontre avec Florence KAING, puéricultrice coordinatrice dans le centre de référence des épilepsies rares
Il existe près de 7.000 maladies rares (le seuil a été fixé à moins d’une personne malade sur 2.000), soit près de 3 millions de patients en France et 300 millions dans le monde. Au sein de l’AP-HM, l’activité maladies rares est riche : 87 centres sont présents dans les services et prennent en charge plus de 50.000 patients par an. Tous les mardis, la plateforme d’expertise maladies rares de l’AP-HM partage avec vous les actions réalisées autour des maladies rares à l’AP-HM: publications scientifiques, participations à une étude, présentations de centres ou d’événements, paroles de patients ou de soignants, etc. Une façon de mettre en valeur et faire connaitre le travail remarquable des professionnels de santé pour accueillir et aider au mieux les patients et les familles touchés par les maladies rares. Suivez-nous sur notre site internet ou notre page LinkedIn.
L’épilepsie est, après la migraine, le trouble neurologique le plus répandu. En France, elle concerne près de 700.000 personnes. Chaque année, environ 4.000 enfants de moins de 10 ans en développent une forme. Cette pathologie survient lorsque certains neurones du cerveau émettent des décharges électriques excessives, entraînant des crises dont les manifestations cliniques peuvent être très variées.
Parmi les différentes formes d’épilepsie, certaines sont dites « rares » car elles touchent moins d’une personne sur 2.000. Parmi les épilepsies rares, les formes les plus précoces et sévères sont souvent les encéphalopathies épileptiques. Il s’agit d’un ensemble de maladies caractérisées par une activité épileptique fréquente et intense, à l’origine de troubles progressifs moteurs, sensoriels, cognitifs et comportementaux, souvent à l’origine de handicaps sévères. Ces formes peuvent apparaître à des âges divers et sont souvent résistantes aux traitements classiques.
Le diagnostic et la prise en charge des épilepsies rares sont complexes et nécessitent un recours à des équipes pluridisciplinaires spécialisées. À l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille (AP-HM), le centre de référence des épilepsies rares, intégré à la filière Defiscience, est coordonné par le Professeur BARTOLOMEI au sein du service de neurophysiologie et rythmologie cérébrale de l’Hôpital de la Timone.
Ce centre se compose d’une équipe dédiée à la prise en charge des adultes, dirigée par le Pr BARTOLOMEI, et d’un volet pédiatrique encadré par le Pr MILH, situé dans l’unité de neuro-métabolisme pédiatrique de l’Hôpital de la Timone Enfants. Florence KAING, infirmière puéricultrice coordinatrice de la section pédiatrique du centre, a accepté de répondre à nos questions pour nous faire découvrir son métier et nous en dire plus sur l’accompagnement des patients atteints d’épilepsies rares.

Florence KAING est infirmière puéricultrice coordinatrice dans le centre de référence des épilepsies rares
Bonjour, pouvez-vous nous expliquer votre parcours avant d’occuper votre poste actuel ?
Bonjour, j’ai suivi une formation d’infirmière dans le Loir-et-Cher, et j’ai obtenu mon diplôme en 2007. J’ai ensuite travaillé à l’Hôpital Necker jusqu’en 2010, au sein du service de neurométabolisme. Par la suite, j’ai intégré l’Hôpital de la Timone, où j’ai obtenu mon diplôme de puéricultrice. Depuis 2020, je fais partie de l’équipe pédiatrique du centre de référence des épilepsies rares, où j’exerce en tant que coordinatrice de soins.
Dans le futur, j’aimerais passer le diplôme d’infirmière en pratiques avancées (IPA).
Pouvez-vous nous décrire le centre coordonnateur des épilepsies rares ?
Le centre de référence des épilepsies rares (CREER) réunit une équipe pluridisciplinaire dédiée aux patients souffrant de ces pathologies. Il est divisé en deux branches : une pour les adultes, dirigée par le Pr BARTOLOMEI, et une pour les enfants, coordonnée par le Pr MILH. Ces 2 équipes travaillent ensemble car les épilepsies rares durent souvent toute la vie.
Dans le cadre de la prise en charge pédiatrique, nous suivons environ 1.500 enfants, soit une moyenne de 25 par semaine.
Depuis la création du centre, nous avons constaté une réduction des hospitalisations de ces patients, grâce à la mise en place d’un suivi plus régulier et adapté.
Quel est votre rôle dans ce CRMR?
Je mène des missions diversifiées :
- En tant que coordinatrice de soins, j’organise les séjours en hospitalisation de jour (HDJ) des patients, qui viennent effectuer des examens tels que des imageries par résonance magnétique (IRM), des électroencéphalogrammes (EEG), des pet-scanners, des bilans neuropsy, des suivis psychologiques, des bilan sanguins et/ou des scanners. Dans ce cadre, j’organise le travail des infirmières et des auxiliaires puéricultrices. Je coordonne également le suivi avec les personnels soignants de ville (médecin généraliste, kinésithérapeute, CAMSP, IME, etc.).
- Durant l’HDJ, je participe aux consultations avec d’autres professionnels (neuropédiatres, psychologues, etc.), en fonction des besoins spécifiques des patients.
- Depuis environ un an et demi, nous avons mis en place des évaluations scolaires en collaboration avec Brigitte OSPINA, une enseignante du service, afin de soutenir les patients en difficulté scolaire.
- Je gère également le suivi des appels et des urgences. Depuis près d’un an, j’organise si nécessaire lors d’un HDJ d’urgence des rendez-vous pour évaluer l’état de santé des patients en cas de doute.
- Enfin, je suis le point de contact privilégié pour les familles, qui peuvent me contacter en cas de questions ou de doutes.
Quels âges ont les patients que vous recevez ?
Nous accueillons des patients âgés de quelques jours à 27 ans (âge de la patiente la plus âgée). L’immense majorité à moins de 18 ans, voir moins de 10 ans. Avant leur transfert vers les services adultes, nous veillons à ce que les patients soient stables au niveau de leur traitement. Bien qu’ils puissent encore présenter des crises, ils parviennent à les gérer.
Parfois, le suivi commence en anténatal par des échographies et consultations assurées par Le Dr Béatrice DESNOUS et le Pr Mathieu MILH à la maternité de l’Hôpital de la Conception.
Nous prévoyons ensuite une HDJ pour ces nouveau-nés, afin de réaliser des examens comme une IRM, un EEG de sieste (lorsque l’enfant est en repos total), ainsi que des consultations pour dépister une épilepsie précoce.
Comment s’organise l’hospitalisation de jour ?
En moyenne, les patients sont reçus en hospitalisation de jour (HDJ) deux fois par an pour faire le point sur leur état de santé. Certains patients n’ont besoin que d’une seule visite annuelle, tandis que d’autres peuvent en avoir davantage, en fonction de l’évolution de leur maladie.
Pour une première hospitalisation, les demandes doivent être envoyées à l’adresse générique allo.neuropediatrie@ap-hm.fr, accompagnées d’une lettre du médecin traitant et des examens réalisés. Les secrétaires trient ces demandes, puis le Pr MILH les analyse et organise la prise en charge. Cela peut se traduire par une simple consultation avec un neuropédiatre ou une hospitalisation en HDJ.
Comme mentionné précédemment, lors de l’HDJ, les patients passent plusieurs examens, tels qu’un EEG, une IRM, un scanner, un bilan sanguin, etc. Ils consultent également différents spécialistes, notamment un neuropédiatre et une infirmière.
Avec quels autres professionnels travaillez-vous ?
La prise en charge des patients au centre de référence CREER est assurée par une équipe pluridisciplinaire, incluant notamment :
- Des manipulateurs et infirmiers d’EEG
- Des neuropédiatres : Dr VILLENEUVE, Dr LÉPINE, Dr DESNOUS, Pr MILH et les Chefs de Cliniques Assistants
- Des internes
- Des infirmières et auxiliaires
- Une psychologue
- Des neuropsychologues
- Des secrétaires
- Une institutrice
Je participe à des réunions (staffs) chaque mardi matin pour discuter des dossiers des patients et organiser au mieux leur prise en charge. Le jeudi matin, des staffs neurochirurgicaux sont également programmés afin de coordonner la prise en charge des patients nécessitant l’implantation d’électrodes et/ou l’exploration pré-chirurgicale. Dans ce cas, les enfants sont hospitalisés dans le service adulte du Pr BARTOLOMEI.
Je fais aussi le lien lorsque les patients atteints d’épilepsie rare sont hospitalisés avec l’équipe du service d’hospitalisation de neuropédiatrie du 6ème étage, infirmières et auxiliaires de puériculture qui sont elles aussi formées à l’épilepsie.
En parallèle, nous maintenons des liens étroits avec les professionnels qui suivent les patients en dehors de l’hôpital.
Comment accompagnez-vous les enfants vers les centres adultes ?
Pour faciliter la transition vers le service adulte, nous collaborons avec L'APPART’, un espace dédié situé à l’Hôpital de la Timone. À L’APPART’, les patients sont accompagnés dans un processus progressif d’acquisition d’autonomie. Ils bénéficient de consultations successives, d'abord avec des neuropédiatres, puis avec des neurologues adultes. Ils participent également à divers ateliers et commencent à se préparer à leur futur professionnel.
De mon côté, j'essaie de les responsabiliser progressivement en leur confiant des tâches comme la gestion de leur pilulier ou la coordination de leurs rendez-vous dès l'âge de 14 ans.
Quelles sont les répercussions de la maladie sur les familles ?
Les familles sont souvent très anxieuses face à l’état de santé des patients, craignant notamment un décès lors des crises. Lors de l’annonce du diagnostic, elles redoutent de ne pas savoir gérer la situation et ont peur d’être stigmatisées. Elles peuvent également se sentir très fatiguées, avec des difficultés à dormir, et sont à risque de développer une dépression. Nous leur proposons un accompagnement avec une psychologue pour les aider à mieux gérer leur stress et leurs émotions.
Comment votre métier a-t-il évolué ?
Mon métier est en constante évolution grâce aux avancées des connaissances sur les épilepsies rares, tant en termes de prise en charge que de traitements. Par exemple, lorsque j’ai débuté, les patients recevaient du valium en intra-rectal, tandis qu’aujourd’hui, le traitement est administré directement par voie orale. Ce changement a grandement facilité l’adhérence au traitement et a amélioré la qualité de vie des patients et de leurs familles.
Les progrès en génétique ont également permis des diagnostics plus précoces et une prise en charge plus rapide des patients.
Mon rôle s’oriente de plus en plus vers une approche globale, où je m’occupe non seulement des séjours des patients, mais aussi de la coordination de leur suivi en dehors de l’hôpital.
Un grand merci à Florence pour son implication, sa passion et son travail quotidien afin d’améliorer la prise en charge des patients !